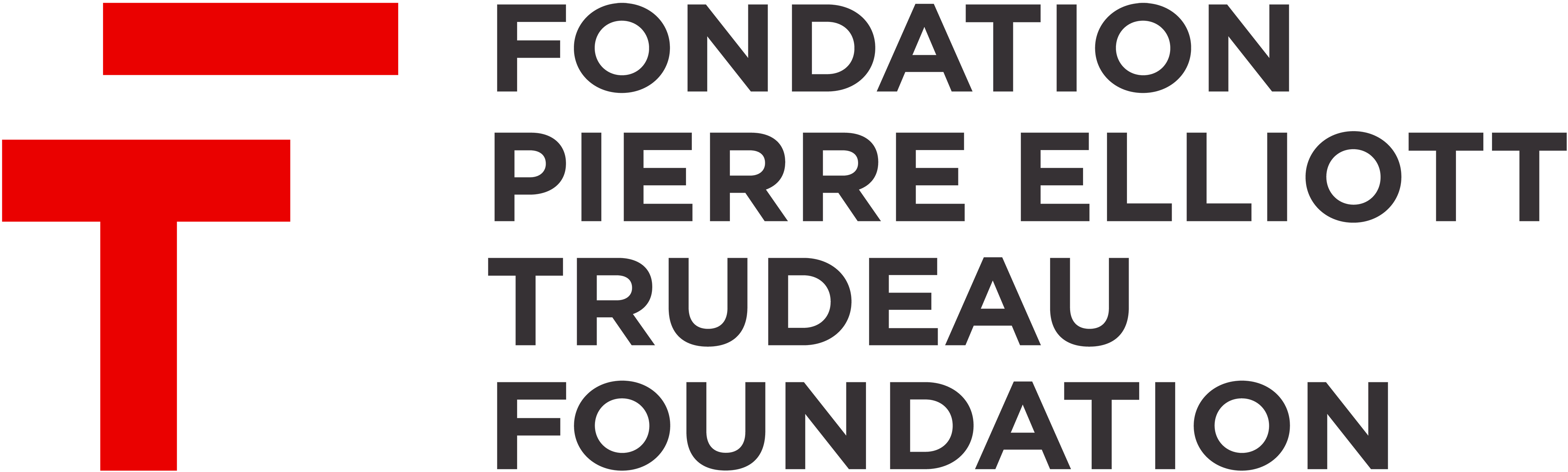Affichage des résultats 241 - 250 de 1011

Infolettre - Juin 2022
Alors que la Fondation fêtera cette année ses 20 ans d’existence, nous sommes tou.te.s bien fier.e.s et bien heureux.ses d’avoir enfin révélé l’identité de nos 13 boursier.e.s 2022-2025 !

La réconciliation est un voyage, pas une destination
La réconciliation est un voyage, pas une destination

Nkwelutenlhkalha - Notre parler. Les langues autochtones et la Décennie des langues autochtones 2022-2032 décrétée par l’ONU
Nkwelutenlhkalha - Notre parler. Les langues autochtones et la Décennie des langues autochtones 2022-2032 décrétée par l’ONU

Diversité : Lancement d’une nouvelle série de balados « Espaces de courage »
La Fondation Pierre Elliot Trudeau annonce le lancement d’une nouvelle série de balados « Espaces de courage » portant sur le thème de la diversité animée par Dr Margarida Garcia.

Appel de candidatures pour les boursier.e.s 2023-2026
C’est aujourd’hui que nous lançons le processus de mises en candidature pour les boursier.e.s du cycle 2023-2026. La Fondation poursuit ainsi sa mission en décernant cette bourse remarquable aux doctorant.e.s les plus brillant.e.s du Canada et de l’étranger.

Recueil d’apprentissages et d’intégration des fellows et mentor.e.s 2021 sur le cycle scientifique Langue, culture et identité
Le langage et les langues sont au cœur du cycle scientifique 2021-2024 de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Au cours de ce cycle, étant donné les liens étroits entre langue, culture et identité, nous tentons d’accorder une attention particulière à ces relations lorsque nous explorons, de façon interdisciplinaire et parfois intersectionnelle, les enjeux et les débats autour de la langue. Ainsi, ce thème met les boursier.e.s au défi de répondre à des questions importantes, à la croisée de la langue (et du langage), de la culture et de l’identité.

Infolettre - Octobre 2022
Malgré de nombreuses périodes marquées par la COVID-19, la dernière année nous a tout de même offert assez de répit pour offrir une programmation diversifiée et enfin tenir plusieurs grands rassemblements en personne, nous permettant ainsi de documenter en profondeur le parcours de nos cohortes, ainsi que les valeurs et les concepts clés de notre programme de leadership.


Intelligence artificielle, médecine, biais et éthique
Intelligence artificielle, médecine, biais et éthique

La vitesse qui tue – les plateformes, l’expression démocratique et le rôle des universités
La vitesse qui tue – les plateformes, l’expression démocratique et le rôle des universités