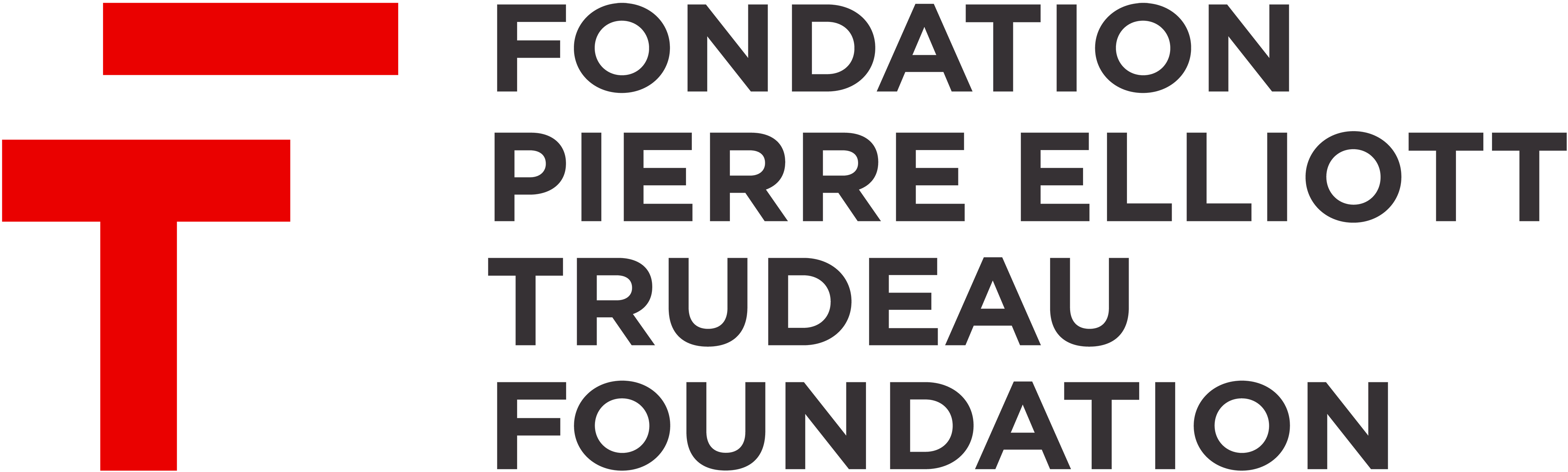Affichage des résultats 271 - 280 de 1011

Le Comité d’étude des demandes et mises en nomination (CÉDMN) 2024
Le Comité d’étude des demandes et mises en nomination (CÉDMN) 2024

Réflexions sur le Mois de l'histoire des Noir.e.s par le professeur Rashid Sumaila
Alors que février touche à sa fin, la Fondation Pierre Elliott Trudeau célèbre un mois essentiel honorant la mémoire collective; un mois entier pour célébrer la véritable histoire, celle qui est écrite, et celle qui ne l’est pas. Un mois qui est unique et texturé par la richesse de la diaspora africaine. Tout au long de l'histoire, les peuples noirs ont façonné la culture, la science, la politique et les arts, laissant une empreinte indélébile sur notre monde.
En clôturant le Mois de l'histoire des Noir.e.s cette année, nous rendons hommage aux contributions remarquables des membres de la communauté noire de la Fondation. Dans cette publication, nous souhaitons partager une inspirante citation d’un nouveau membre, le professeur Rashid Sumaila (Fellow 2023).
En clôturant le Mois de l'histoire des Noir.e.s cette année, nous rendons hommage aux contributions remarquables des membres de la communauté noire de la Fondation. Dans cette publication, nous souhaitons partager une inspirante citation d’un nouveau membre, le professeur Rashid Sumaila (Fellow 2023).

Message adressé à la communauté de la part du Conseil d’administration
La Fondation Pierre Elliott Trudeau a le plaisir d’annoncer la nomination d’une nouvelle présidente et directrice générale par intérim, de même que six Canadiens et Canadiennes remarquables qui siègeront comme administrateurs et administratrices au Conseil d’administration de la Fondation. Ils le feront sous la direction d’un nouveau président du Conseil, à la suite du départ à la retraite bien mérité de son plus récent président.

Célébrer les droits des femmes à travers les thèmes fondamentaux de la fondation
En cette Journée internationale des femmes, nous nous rassemblons pour célébrer les nombreuses réalisations, luttes et triomphes des femmes à travers le monde. C'est une journée pour reconnaître leur résilience, leur détermination et leur contribution inestimable à tous les aspects de la société, en alignement avec les valeurs fondamentales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Aimée Morrison: la neurodivergence en milieu universitaire
Aimée Morrison, fellow 2019, a récemment publié un article dans la revue Biography intitulé “(Un)Reasonable, (Un)Necessary, and (In)Appropriate: Biographic Mediation of Neurodivergence in Academic Accommodations”. À partir de son expérience personnelle, Aimée se penche sur l’accommodement de la neurodivergence chez le corps professoral en milieu universitaire.
Les travaux de recherche d’Aimée portent sur les pratiques quotidiennes des utilisateurs des médias sociaux en tant que formes de récits de vie qui poursuivent fréquemment des objectifs de justice sociale, identitaires ou communautaires. Elle intervient régulièrement dans les médias sur les tendances dans les médias sociaux et sur l’histoire de l’informatique et d’internet
Les travaux de recherche d’Aimée portent sur les pratiques quotidiennes des utilisateurs des médias sociaux en tant que formes de récits de vie qui poursuivent fréquemment des objectifs de justice sociale, identitaires ou communautaires. Elle intervient régulièrement dans les médias sur les tendances dans les médias sociaux et sur l’histoire de l’informatique et d’internet

Passionnante immersion auprès de la Corporation Mushuau-nipi
Le mois d’août s’est terminé de belle façon pour nos boursier.e.s, qui ont eu l’opportunité de participer à un Séjour autochtone exclusif organisée par les membres de la Corporation Mushuau-nipi. Les boursiers.e.s., accompagnés de Winter Fedyk (Mentore 2023), Jean-Frédéric Morin (Fellow 2022) et Monique Smith (Mentore 2022), ont littéralement eu l’opportunité de voyager au bout du monde, se rendant au nord du 56e parallèle, et en s’immergeant de l’histoire, de la culture et de la langue des Innus et des Naskapis du Québec et du Labrador.

Les finalistes pour la bourse Pierre Elliott Trudeau 2024 se préparent
La Fondation Pierre Elliott Trudeau est ravie d'annoncer les 30 finalistes exceptionnels du programme de bourses 2024. Les finalistes se sont distingués parmi près de 500 étudiantes et étudiants au doctorat de diverses régions du Canada et du monde entier qui ont posé leur candidature à notre programme unique qui fournit un financement généreux pour la recherche, une allocation de recherche et de voyage et offre des formations de leadership.

Exploration des économies mondiales à Washington, DC
Un groupe de boursiers et boursières 2022, cohorte dont le thème du cycle scientifique est "Les économies mondiales", a commencé l'année par un voyage à Washington, DC, pour rencontrer des représentants d'institutions clés qui influencent les politiques économiques mondiales et régionales. Le voyage a été organisé par Monique Smith (Mentore 2022).

Célébrer l'engagement mondial en faveur de la santé et du bien-être
Considérant la journée mondiale de la santé le 7 avril, la Fondation Pierre Elliott Trudeau souhaite profiter de l'occasion pour célébrer l'engagement mondial en faveur de la santé et du bien-être. À cette occasion, nous aimerions présenter quelques études et documents de recherche significatifs de nos boursières et boursiers actifs. Ces contributions démontrent non seulement notre engagement collectif à faire progresser les connaissances dans le domaine de la santé, mais elles mettent également en lumière les approches et les points de vue novateurs que nos boursiers et boursières apportent pour relever des défis complexes en santé.

La cohorte 2022 est à Buenos Aires !
La cohorte 2022 se retrouve dans la capitale de l'Argentine pour son Institut international du leadership engagé.